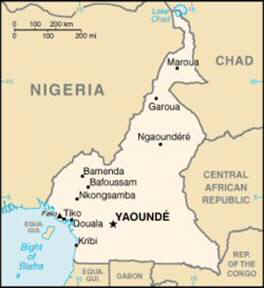
Saibou Issa
Université de Ngaoundéré
Introduction
Depuis le milieu des années 1980, les confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad
sont des espaces de désordre où l’autorité de l’Etat peine à s’imposer
du fait de la prolifération des bandes armées de rebelles, de trafiquants divers et de
bandits de grand chemin connus sous l’appellation de « coupeurs de routes ». Usant
et abusant de la porosité des frontières et des solidarités transfrontalières dans des
aires culturelles qui transcendent les limites d’Etats, l’économie illégale se
nourrit de la floraison des vecteurs de la violence issus de l’instabilité politique
dans le Bassin du Lac Tchad et particulièrement au Tchad où depuis 1966, la récurrente
scissiparité des groupes rebelles a généré une pléthore de bandes armées qui
arpentent les zones frontalières. A la suite des multiples guerres civiles, rébellions
et changements de régimes qui ont jalonné l’histoire politique du Tchad et de la
Centrafrique, et du fait de la crise économique, l’on a assisté à la résurgence
de la criminalité rurale animée par des praticiens connus sous l’appellation
générique de « coupeurs de route » du fait du procédé d’embuscade sur la
chaussée qui caractérise généralement leur mode d’opération (Saibou, 2004).
Phénomène polysémique, le banditisme de grand chemin s’est enrichi d’une main
d’œuvre abondante du fait de la prolifération des sans emplois, d’une main
d’œuvre experte du fait de la prolifération de combattants anciens ou en
activité et d’une logistique conséquente du fait de la prolifération des armes de
guerre passées aux mains des populations dans un contexte de militarisation de
l’ethnie. Ainsi naquirent des bandes aussi, sinon mieux aguerries que les armées
régulières. Du maintien de l’ordre renforcé, la répression du banditisme rural
transfrontalier est devenue une préoccupation de défense nationale à cause du
professionnalisme des bandits et de leur transmigration d’un Etat à l’autre.
Une logique du tout-répressif fut mise en œuvre, aboutissant à un « assainissement
» du climat sécuritaire, mais au prix d’éliminations systématiques des bandits.
C’est ainsi qu’en 2002 au Cameroun par exemple, la liquidation des bandits avait
concrètement décapité le grand banditisme dont la plupart des commanditaires et des
capitaines avaient perdu la vie ou traversé la frontière, quelques-uns croupissant en
prison. En tout cas, malgré les récriminations au sujet de la violation des droits de
l’homme, les actions simultanées des unités spéciales (1)
de répression du grand banditisme ont donné une impression de sécurité retrouvée
aussi bien en ville qu’en campagne.
Mais l’une des constantes de l’histoire du banditisme de grand chemin en Afrique
subsaharienne, c’est sa capacité à se reproduire, à muter au gré des changements
de la politique répressive de l’Etat, et au gré de l’apparition de nouvelles
conjonctures criminogènes, lesquelles disséminent de nouveaux vecteurs de
l’agression et de nouveaux acteurs de la criminalité transfrontalière. Ainsi
peut-on dire du banditisme transfrontalier qu’il est un phénomène cyclique.
C’est dans ce sens que l’on a assisté, à partir de 2003, à l’apparition
de la prise d’otages dans les zones frontalières comme nouvelle modalité du
phénomène du banditisme de grand chemin. Cette contribution en étudie les sources, les
acteurs, l’organisation et les conséquences. Il s’agit tout d’abord de
montrer comment les répercussions de la sécheresse sur les éleveurs nomades et
l’instabilité politique en Centrafrique se combinent pour générer un contexte
favorable à l’émergence de nouveaux acteurs du banditisme transfrontalier. La
deuxième partie de l’étude analyse l’innovation que représente la prise
d’otages à travers sa rationalité et son organisation. Il s’agit enfin
d’examiner les conséquences à court terme de ce phénomène sur les populations,
les politiques étatiques et le contrôle de l’espace frontalier.
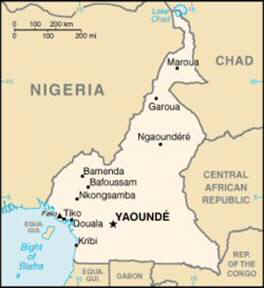
Carte de localisation de la zone d’étude
Un contexte de crise générateur de la criminalité d’investissement
Mes travaux précédents ont montré comment la récurrence de l’adversité
économique a généré dans le bassin du Lac Tchad une culture de rapine caractéristique
d’économies de subsistance, tolérante envers les déviances de subsistance.
Perpétrée par les chefs de famille, les chefs de villages et les patrons des grandes
hégémonies politiques précoloniales ou commanditée tout récemment encore par les
autorités traditionnelles pourtant auxiliaires de l’administration, l’agression
à main armée permettait de supporter les charges sociales du leadership dans un
environnement où le rang et l’image de l’individu dans la société tiennent
surtout à sa capacité à satisfaire les besoins quotidiens de ses dépendants, de ses
clients. Comme l’ont remarqué les explorateurs européens qui ont sillonné la
région au cours du 19è siècle et les administrateurs coloniaux allemands et français
au Cameroun et au Tchad, la tâche la plus ardue de l’entreprise européenne
n’était pas la conquête du territoire et son arrimage aux domaines coloniaux de la
métropole, mais bien plus la conquête des mentalités façonnées par la rudesse du
climat, les coutumes martiales et la précarité. Plus tard, lorsque le Tchad entra dans
une instabilité de longue durée marquée par l’alternance violente des régimes
politiques à N’djamena et la dissémination des groupes armés sur l’ensemble
du territoire, les rebelles se muèrent en groupes de rebelles-bandits usant du banditisme
transfrontalier dans la région du Lac Tchad notamment pour se ravitailler en moyens de
subsistance. Simultanément à ce banditisme alimentaire, l’on a vu progressivement
émerger des bandes multinationales soutenues par des commanditaires et motivées par la
recherche d’un gain important vraisemblablement recyclé dans l’économie
formelle. Sur le terreau de cette criminalité combinatoire de l’agression, du trafic
d’armes et de la contrebande de métaux précieux, s’est développée une
économie du crime qui profite d’un contexte de crise, et dont les pasteurs Mbororo
et les mercenaires tchadiens en activité en Centrafrique sont les acteurs désignés.
De la marginalité criminogène des pasteurs Mbororo
Les pasteurs Mbororo du Cameroun et de Centrafrique présentent une image contrastée dans
l’économie du banditisme contemporain. Ils en sont acteurs dans la mesure où nombre
de groupes armés composés de Mbororo ont souvent été appréhendés par les forces de
l’ordre, ou identifiés comme tels par les victimes d’embuscades ou de raids
dans les zones d’élevage. Ils sont cependant les principales victimes des
enlèvements d’enfants et de bergers dans le nord-ouest de la Centrafrique et
l’Adamaoua au Cameroun. Cette dualité de leur relation au crime organisé tire ses
sources dans une longue histoire de marginalité tirant ses sources dans leur mode de vie,
l’impact des crises écologiques sur leur système socio-culturel et
l’exploitation dont ils sont l’objet.
Avec les Pygmées de la forêt équatoriale, les Mbororo sont l’une des deux
minorités ethniques officiellement reconnues comme telles par les autorités
camerounaises. Ces éleveurs nomades dont une partie est néanmoins sédentarisée,
mènent une vie de migration, transhumant par delà les frontières régionales et
nationales. L’élevage sentimental du boeuf est la pierre angulaire de leur vie
socio-économique, car le boeuf est pour le Mbororo davantage un marqueur identitaire
qu’une thésaurisation animale. Appartenant au grand groupe peul, ils restent de tous
leurs congénères, ceux dont le mode de vie se rapproche encore de l’époque
préislamique. Pour les Peuls sédentarisés propagateurs de l’Islam, intégrés dans
les circuits économiques, bâtisseurs d’hégémonies politiques précoloniales et
profondément ancrés dans l’administration publique et les rouages politiques de
l’Etat moderne, la persistance de la vie d’Hermite de ces Fulße ladde,
”Peuls de la brousse”, fait désordre. Ils portent préjudice à l’image
nobiliaire et seigneuriale que véhicule l’endoperception peule du Nord-Cameroun.
Leur instabilité religieuse entre une pratique de l’islam dite superficielle, la
persistance de pratiques païennes chez certains et une sensibilité à
l’évangélisation par l’église évangélique luthérienne norvégienne chez
d’autres, n’est pas du goût de ceux qui, au Nord-Cameroun en particulier,
confondent ethnie et religion, Peuls et islam. De fait, tandis que pour bien de Peuls les
Mbororo sont un groupe ethnique à part entière, les Mbororo encore ancrés dans la
tradition perçoivent leurs congénères sédentaires comme une race abâtardie par
l’abandon de la transhumance saisonnière, la pécuniarisation du boeuf et le
brassage ethnique avec les ßaleeße, littéralement ”les Noirs” pour désigner
les peuples aux traits négroïdes de la plaine du Diamaré ou du plateau de
l’Adamaoua (Bocquéné, 1986).
Lorsque les épisodes de sécheresses sévères de 1972-1973, 1983-1985 et 1996
s’abattirent sur le Sahel englobant le Bassin du Lac Tchad, les éleveurs furent ceux
qui en subirent le plus les conséquences. En plus des épizooties, l’assèchement
des points d’eau et la rareté des pâturages décimèrent le bétail, obligeant les
pasteurs sans bétail à se reconvertir dans l’agriculture qu’ils honnissent,
dans le gardiennage du bétail, voire la prostitution pour les femmes, la mendicité et
l’alcoolisme pour les jeunes hommes(2).
En effet, la conjonction de tous ces facteurs d’exclusion n’offre aucune
perspective reluisante aux Mbororo sans bétail, dès lors que la reconstitution du
bétail est le seul gage de reconstitution de leur identité, de leur code éthique, le
Pulaaku. Or, avec leur solde de berger, il faut plus d’un an de labeur pour acheter
un taurillon, au moins une décennie pour posséder un embryon de troupeau. Cette
situation incite à emprunter des raccourcis. C’est ainsi que des bergers mbororo ont
parfois détourné le bétail dont ils avaient la garde, tandis que d’autres parmi
leurs congénères constituent des groupes qui tendent des embuscades ou font des raids
sur les campements. A cela s’ajoute le fait que les Mbororo sans bétail qui ne
reçoivent pas l’assistance de ceux qui en possèdent, deviennent de potentiels
adversaires, d’où des risques de transfert violent de propriété à
l’intérieur même de la société Mbororo. Vu sous cet angle, les motivations des
bandits mbororo tendent à s’inscrire dans une logique de reproduction du phénomène
du crime social dans le sens où l’entend John Lea quand il écrit : « I have
suggested that the concept of social crime can serve as a starting point for the
exploration of the complex and conflicting ways in which protest or survival strategies
interface with violence and oppression in both the criminal and widening sections of the
legitimate economy ». (Lea, 1999 : 322)
Le tableau de la marginalité criminogène des Mbororo ne serait pas complet si on ne
mettait en exergue le potentiel de révolte que renferme l’exploitation dont ils sont
l’objet de la part des détenteurs de l’autorité. Comme le dit si bien Ndoudi
Oumarou, Mbororo du Nord-Cameroun, leur errance et leur analphabétisme les rendent
vulnérables : « quel que soit l’endroit où nous nous trouvons, aucune
considération ne nous est due, à nous les Mbororo. Comment l’expliquer ? Nous
sommes des gens sans village et sans terre, des illettrés, peu instruits de notre
religion, ne sachant rien des choses du monde […]. Tel est notre sort, à nous gens
de la brousse, nomades sans instruction, tout juste bons à être exploités en tous lieux
et par tous ! ». Ainsi en est-il des autorités traditionnelles, notamment peules, qui
multiplient les prélèvements d’animaux, les redevances en nature, les taxes de
pacage et autres amendes qui ponctionnent leurs troupeaux. En témoigne cet extrait
d’une plainte d’un éleveur Mbororo adressée au Préfet du Département de
l’Adamaoua en 1963 relatant les confiscations de bétail, l’emprisonnement et
l’extorsion d’argent avant d’implorer : « Il faut bien demander,
qu’est-ce j’ai fait, un simple Bororo comme moi, qu’est-ce que je peux
faire aux Lamidos, ce sont eux qui luttent pour les biens des pauvres. Je vous dis en
vérité que je ne suis pas tranquille à cause de mes bœufs […] Sauvez-moi de
ces gens ». C’est là un exemple parmi tant de documents d’archives coloniales
et postcoloniales, de plaintes en justice ou auprès des autorités administratives,
d’exactions portées à la connaissance du bureau de MBOSCUDA .
La réponse des Mbororo à cette pression sur leur bétail est la réponse traditionnelle
des nomades, à savoir s’en aller, migrer vers des contrées plus clémentes. Ainsi,
quand les pâturages diminuèrent considérablement à cause de la récurrence de la
sécheresse et de l’extension des ranchs dans l’Adamaoua et le Nord-Ouest, quand
les coupeurs de route s’acharnèrent contre les éleveurs dans leurs villages et aux
abords des marchés à bétail, quand certains détenteurs de l’autorité devinrent
toujours plus exigeants, les pasteurs Mbororo du Cameroun emportèrent leurs familles et
leurs troupeaux vers le nord-ouest de la Centrafrique, zone riche en pâturages,
relativement paisible, aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad. Le
mouvement s’intensifia au début des années 1990, période marquée par la
recrudescence de la criminalité rurale au Nord-cameroun, alors que l’accesion au
pouvoir d’Ange-Félix Patassé à Bangui redonnait espoir au pays voisin. Mais cette
embellie ne dura pas, car bientôt la Centrafrique allait connaître un cycle de
mutineries, la rébellion et le changement de régime grâce à l’appui de
mercenaires tchadiens. Ex-mutins et ex-Libérateurs deviennent de nouveaux acteurs de la
criminalité transfrontalière.
Les ”Libérateurs”, nouveaux acteurs de la criminalité militaire
transfrontalière
C’est en se militarisant que le banditisme transfrontalier sort de son cadre
traditionnel pour devenir un phénomène polémologique. Il en est ainsi depuis des
siècles, car le phénomène est tributaire des conflits qui ont cours dans les Etats ou
dans les relations interétatiques. Pareille conjoncture a toujours favorisé
l’émergence de réseaux criminels sous la forme de l’entrepreunariat
d’insécurité dans des régions telles que la Corne de l’Afrique et la région
des Grands Lacs. En Afrique de l’Est, persistent encore les mentalités
crimino-tolérantes, cependant comme le souligne Nene Mburu, «although the motive for
contemporary banditry is the pauperization of people that live in a harsh physical
environment, the opportunity and means emanate from existing political turmoil in the
region where recent civil wars have made arms bearing a part of their material culture
».(Mburu, 1999 : 90) Ainsi, aux confins de l’Erythrée, de l’Ethiopie, du
Kenya, de la Somalie et du Soudan, se déploient des familles de bandits qui tirent partie
de l’instabilité chronique dans cette région soumise à la récurrence et à la
pluralité des formes de violences rendant difficile le contrôle des zones frontalières.
Au nombre des entreprises criminelles figurent notamment les Shifta à propos desquels
Nene Mburu écrit que «contemprorary banditry along Kenya’s border with Ethiopia and
Somalia is a consequence of a failed rehabilitation of former veterans of the four years
secessionist conflict that was supported by the Republic of Somalia.» (Mburu, 1999 : 99)
Le Tchad offre un exemple similaire. La guerre civile et la prolifération des rébellions
et des mouvements armés dits ”politico-militaires” depuis 1966 y a multiplié
les porteurs d’armes, qu’ils soient d’anciens éléments de l’armée
régulière passés à la ”vie civile” après la déchéance du Président, ou
des combattants affiliés aux dizaines de mouvements armés disséminés sur le territoire
tchadien. Parmi ces combattants, furent parfois recrutés des mercenaires dans les
conflits interethniques comme ce fut le cas dans l’extrême-nord du Cameroun. Leur
rôle dans l’exacerbation de l’insécurité sous-régionale ne fait l’ombre
d’aucun doute dans un contexte de faillite de l’Etat tchadien dans sa mission de
protection des hommes et des biens, de criminalisation des modes de mobilités sociales
générateurs de révolutions statutaires spontanées, de privatisation du service public
à des fins d’enrichissement selon la logique cleptocratique (Bayart et al, 1999 :
1-31). Au Tchad particulièrement, où la politique de réduction des effectifs et de
professionnalisation de l’armée a donné des résultats mitigés, divaguent de
dizaines de milliers de professionnels de la gâchette pour qui le fusil en réserve est
devenu l’outil atavique de production aussi bien du politique que de
l’économique (Buijtenhuijs, 1998: 93-112). C’est dans ce contexte belligène
que le Tchad a entrepris son ouverture démocratique.
Mais à l’opposé de la théorie du democratic peace, la transition démocratique en
Afrique Centrale est plutôt belligène comme le montrent les conditions de remplacement
de Hissène Habré au Tchad, Mobutu Sese Seko au Zaïre et Pascal Lissouba au Congo. Face
aux démocratisations bloquées, l’armée a été la productrice d’alternance,
mais c’est généralement d’une armée milicienne qu’il s’est
s’agi dès lors que ses éléments sont recrutés sur des bases affinitaires. Tandis
que ça et là des mécanismes de sortie de crise favorisent des retours à l’ordre
politique multipartite, l’expansion des régimes militaro-civils se confirme en
Afrique Centrale selon la logique de la conquête du pouvoir par les armes et sa
légitimation par les urnes. La conjonction des armées parapubliques et des généraux
démocratiques fait des émules dans un contexte de succès du parrainage
militaro-politique à l’étranger. L’exemple du Congo est là pour montrer
l’applicabilité du droit d’ingérence pour cause de sécurité nationale, la
communauté internationale ayant validé l’arrivée de Denis Sassou Nguesso grâce
aux renforts de Eduardo dos Santos d’Angola. Dans cet ordre d’idée, le
Président tchadien Idris Déby Itno dont des soldats avaient intervenu en République
Démocratique du Congo aux côtés des troupes gouvernementales de Laurent-Désiré
Kabila, semble avoir assimilé la leçon des deux Congo, en apportant son soutien au chef
d’état-major dissident de l’armée centrafricaine, le Général François
Bozizé. N’Djamena et Bangui s’accusaient alors mutuellement d’abriter des
mouvements armés hostiles dans leurs zones frontalières respectives. Le Président
centrafricain Ange-Félix Patassé avait alors maille à partir avec son armée que
secouèrent trois mutineries pour la seule année 1996. Partagée suivant une ligne de
fracture ethnique et régionale, sans salaire, l’armée centrafricaine multiplie les
pillages devenant le principal acteur de l’insécurité dans ce pays, dont les
populations otages dans un Etat en banqueroute avaient besoin d’être libérées de
ses bourreaux ”patasséens”; d’où les ”Libérateurs”.
La bienveillance active d’Idris Déby dans le processus qui conduit François Bozizé
au pouvoir à Bangui est une réalité admise. S’agissant des modalités de cet
appui, l’on sait que c’est du Tchad où il s’était réfugié que le
Général rebelle lance en 2002 l’offensive qui le conduit au pouvoir. De plus,
diverses sources indiquent que ses troupes comprenaient outre les éléments
centrafricains qui lui étaient restés fidèles, des soldats et autres combattants
tchadiens et soudanais présentés comme ressortissants de l’ethnie Zaghawa du
Président Idris Déby. Entre mécénat et mercenariat, cette troupe étrangère a
concrétisé l’adoubement de Bozizé en contrepartie des promesses de rétribution
une fois le pouvoir conquis. Mais l’euphorie de la victoire céda vite la place à
l’amertume, générant des comportements prédateurs
Si les taux de la rétribution promise aux ”libérateurs” et les montants exacts
reçus varient selon les sources, ces dernières concordent néanmoins pour dire que les
espoirs de ces mercenaires d’un genre nouveau ont été déçus. Déception
financière, mais aussi déception sociale quand on les compare à la place des Soudanais
et des Rwandais dans les arènes tchadienne et congolaise, en contrepartie de l’appui
déterminant qu’ils ont respectivement apporté à Idris Déby et Laurent-Désiré
Kabila dans leurs marches triomphales vers la prise du pouvoir à N’djamena en 1990
et au Zaïre devenu République Démocratique du Congo en 1997. Bien plus, diverses
sources indiquent que les ”libérateurs” étrangers devenus encombrants pour
Bangui, n’étaient pas les bienvenus au Tchad où ils risquaient de transformer leur
frustration en redoutable main d’oeuvre anti-Déby: « Les autorités de N'Djamena
verraient d'un très mauvais oeil le retour sur le sol tchadien de ces «Zakawa» qui
constitueraient une menace pour le pays de Déby » (Emangongo, 2005).
Le chef de l’Etat tchadien faisait alors face à une succession de défections aussi
bien parmi les éléments clés du cercle restreint du pouvoir que parmi les militaires
Zaghawa qui constituent le socle de sa garde rapprochée. Rejetés à Bangui et redoutés
à N’Djamena, les ”libérateurs” deviennent un boulet apatride qui
transforme son errance en ressource aux confins poreux des trois pays où sévissait
déjà le banditisme transfrontalier.
Il importe cependant de noter que si l’expression "libérateurs" renvoie
surtout aux mercenaires Zaghawa qui ont accompagné François Bozizé à Bangui, les
acteurs du renouveau du grand banditisme transfrontalier qu’on désigne sous cette
expression comprennent également les milices et autres groupes armés constitués
d’anciens soldats de l’armée centrafricaine, car en dépit des initiatives
prises dans le cadre de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et
réinsertion (CNDDR) pour recaser quelques 6000 militaires, ”certains avaient
préféré garder leurs armes et se reconvertir en coupeurs de route”. A ceux-là il
convient d’ajouter l’éternelle question de l’implication récurrente de
militaires tchadiens dans la crise de l’insécurité au Nord-Cameroun. Si lors de la
réunion de la commission mixte de sécurité entre le Cameroun et le Tchad en 1994 cette
question fut sujette à polémique, le secret de polichinelle est aujourd’hui admis
comme une vérité. Ce que corrobore par exemple Mbodu Saïd, Consul du Tchad à Garoua au
Cameroun: ”C’est vrai qu’il y a des soldats tchadiens qui opèrent au
Cameroun. Ce sont des dissidents de l’armée tchadienne et ceux qui ont été
chassés de la garde présidentielle.” Propos de diplomates qui masquent mal
l’embarras de l’Etat face à des soldats tantôt ”dissidents” tantôt
”égarés” qui complètent leur solde en usant de leurs armes et de leur
expertise dans l’espace de non droit que sont les zones frontalières. Bien payés,
recevant une solde de survie ou accumulant des années d’arriérés de salaires, les
militaires d’Afrique Centrale traversent une crise de genre de vie caractéristique
d’une existence quotidienne dépensière (femmes, boisson, progéniture nombreuse),
d’un budget mensuel déficitaire toujours à la solde des usuriers et dans nombre de
cas résultant de la reproduction d’une jeunesse délinquante que les rigueurs de la
formation militaire n’ont pas réussi à extirper des mentalités. Autant de facteurs
de déviance de la troupe qu’encourage une économie de transactions à ciel ouvert
où les liasses de billets de banque passent d’une main à une autre, où
l’argent voyage dans les mêmes véhicules et sur les mêmes routes insécures que
les opérateurs économiques.
Au total, les circonstances du changement de régime à Bangui en 2003 ont suscité
l’apparition de nouveaux acteurs de la criminalité transfrontalière. Mais face à
la redoutable action répressive des Etats, il était malaisé de mener des incursions et
tendre des embuscades pendant des heures comme le faisaient les bandes armées dans les
années précédentes. Pour les ”Libérateurs” aigris tout comme pour les
Mbororo désocialisés, la prise d’otages contre rançon s’est imposée comme un
moyen efficace et moins risqué de faire du butin.
Kidnapping, rançon et frontière
Au-delà de l’analyse contextuelle de la prise d’otages proprement dite, cette
nouvelle modalité du banditisme s’inscrit davantage dans une logique de reproduction
que de rupture . Elle pose en effet le problème des razzias post-esclavagistes. Naguère,
au temps des grands empires et royaumes précoloniaux, l’homme vulnérable passible
de razzia était la principale denrée de l’économie de traite. En tant que force de
travail et aisément convertible en devises, la quête de la marchandise humaine
sous-tendait les relations transfrontalières, qu’elles soient des rapports de
vassalité ou des guerres territoriales dont l’un des principaux buts était
d’agrandir l’espace de razzias esclavagistes. Quand les colonisateurs européens
mirent fin aux razzias, le bétail supplanta l’esclave dans les trafics
transfrontaliers. Les razzias de troupeaux et leur exportation vers les colonies voisines
mobilisèrent des réseaux sous-régionaux impliquant des autorités traditionnelles, les
communautés frontalières séparées par la délimitation des possessions coloniales et
des chefs de bandes passés à la postérité grâce aux chansons des griots qui louaient
leur expertise et leur courage (Saibou, 2001). Plus d’un demi-siècle de répression
coloniale ne permit pas d’arrêter les razzias de bétail, comme si cet échec
traduisait toute la difficulté qu’il y avait à extirper des moeurs sociales une
pratique comportant des dimensions économiques et culturelles. Pour les pasteurs, les
razzias de longue distance connues sous le nom de rezzous, étaient des entreprises de
constitution ou de reconstitution des troupeaux volés ou décimés par les aléas
naturels. Pour les jeunes des communautés sédentaires marquées par les pressions
d’un environnement politique et écologique hostile, la razzia pouvait avoir un
aspect initiatique pour les préparer à affronter les rigueurs de l’existence.
Plus tard, les marchés à bétail situés dans les zones frontalières devinrent les
lieux privilégiés d’écoulement du bétail volé de l’autre côté de la
frontière. La complicité due à l’existence des réseaux et la porosité des
frontières favorisèrent les transactions. Parmi les voleurs de bétail, figuraient de
plus en plus des militaires, qu’ils soient issus des multiples fractions armées en
déshérence, des éléments de l’armée régulière ou surtout des soldats
déflatés. Quand il devint de plus en plus malaisé et risqué de traîner des troupeaux
sur des longues distances, l’embuscade ciblée aux abords des marchés à bétail se
substitua aux razzias. Les éleveurs étaient filés et attendus au moment du retour; les
bandits savaient quelle quantité d’argent ils rapportaient de la vente de leurs
animaux. Progressivement, les éleveurs peuls et notamment les Mbororo, apprirent à faire
confiance aux banques, d’où l’installation de coopératives d’épargne et
de crédit aux abords des marchés. Les éleveurs apprirent à négocier et à vendre leur
bétail en contrepartie d’une attestation de vente, d’un chèque pour que
l’argent soit récupéré en ville. Parfois, le marché n’était plus
qu’une bourse de valeurs où l’éleveur venait exposer les caractéristiques de
ses animaux, prendre rendez-vous avec de potentiels acheteurs qui iront examiner la
marchandise en lieu sûr et y conclure la vente.
Pour les bandits, le temps des vaches maigres commence: ils ne peuvent plus razzier les
boeufs pour aller eux-mêmes les vendre; les éleveurs n’empruntent plus les routes
avec des sacs d’argent dans la malle arrière des véhicules. Dès lors, ce sont
désormais les parents qui sont obligés de vendre les boeufs pour aller payer la rançon
exigée. Les Mbororo en sont les principales victimes aussi bien au Cameroun qu’en
Centrafrique.
Pour la Centrafrique, les témoignages que livrent les migrants du banditisme réfugiés
au Cameroun, les rapports relatifs à la situation des droits de l’homme et de
nombreux documents de la presse centrafricaine rendent compte de l’ampleur du
phénomène dans ce pays. Interrogé à ce sujet par la radio nationale centrafricaine
lors de son journal de la mi-journée du 15 septembre 2004, un responsable de
l’association des éleveurs de ce pays témoigne : « Je vais vous donner un exemple
: de janvier au mois de mai de cette année, trois cents enfants d’éleveurs ont
été pris en otages et plus de quatre cent quatre vingt dix millions ont été demandés
en rançon. Et sur le paiement qui a été fait par les éleveurs eux-mêmes, ils ont
payé plus de cent soixante dix millions. » L’interview fait suite à la
présentation aux autorités de Bangui, de dix enfants repris aux coupeurs de route par
des archers réunis au sein d’un comité d’autodéfense nommé «
Anti-Zaraguinas ». L’appel au secours qu’il lance aux hautes autorités
centrafricaines témoigne du désespoir des éleveurs : «Nous avons réussi à libérer
dix de ces enfants après un dur combat. Je vous assure que nous avons vaincu ces
Zaraguinas dans un premier temps. Mais ils ont fait appel par téléphone satellitaire à
une équipe de renforts, bien équipés et leur assaut a été foudroyant (…). Nous
sommes venus rencontrer les autorités pour nous lamenter. Nous n’aimons pas, à
cause de l’insécurité exercée sur nous par les « Zaraguinas », quitter pour
aller au Cameroun ou ailleurs. Simplement parce que nous sommes dépassés. Nous
n’avons de moyens pour défendre nos parents, nos enfants et nous-mêmes. Nous
voulons travailler avec le gouvernement la main dans la main. Nous ne voulons pas fuir.
Nous pouvons nous sacrifier à cause de notre pays. Mais nous voulons que notre arc puisse
être remplacé. Si le gouvernement change notre arme blanche, nous pourrons travailler,
sinon, nous serons obligés, pour protéger nos enfants, d’aller ailleurs».
Si la demande d’une logistique adéquate pour remplacer les armes blanches des «
Anti-Zaraguinas » est légitime, elle est cependant délicate à satisfaire, car
l’identité des bandits est une question polémique; autant des soldats sont
incriminés, autant la communauté peule elle-même n’est pas exempte de tout
soupçon. D’une part l’on estime que « ces enlèvements, qui sont souvent une
forme de racket permettant de se racheter un troupeau ou un règlement de compte entre
éleveurs peulhs appartenant à des tribus différentes, sont récurrents dans les
régions d’élevage de la Centrafrique ». D’autre part, l’on indique que
« sur dix Zaraguinas, on dénombre huit Oudda, c’est-à-dire les peulhs. » Ces
propos montrent toute la complexité de l’économie du crime liée au bétail.
Attaché à ses animaux, l’éleveur doit s’en défaire pour racheter la vie de
son enfant. Commanditaires ou kidnappeurs, les acteurs des enlèvements sont conscients du
fait que la vie d’un enfant est le seul moyen de chantage pour amener l’éleveur
à vendre tout un troupeau. En effet, le paiement de la rançon coûte parfois la valeur
de tout le troupeau, comme le montrent les prises d’otages dont sont victimes les
Mbororo réfugiés dans le Sud tchadien. Pillés et rançonnés, des éleveurs deviennent
parfois eux-mêmes pillards et rançonneurs de leurs congénères: ”Ces phénomènes
d’enlèvements, qui sont souvent une forme de racket permettant de se racheter un
troupeau ou un règlement de compte entre éleveurs peuls appartenant à des tribus
différentes, sont récurrents dans les régions d’élevage de la Centrafrique”.
Au Cameroun également, la prise d’otages au détriment des Mbororo est devenue
quotidienne notamment dans les zones de Ngahoui et Djohong proches de la frontière
centrafricaine et entre Bibémi et Léré de part et d’autre de la frontière
tchado-camerounaise. Les sources militaires l’indiquaient clairement déjà pour
l’année 2004: «Ces prises d’otages exclusivement effectuées sur les
populations d’ethnie Bororo, sont rendues possibles à cause du manque de
collaboration de ces derniers qui vivent en autarcie dans leurs campements craignant les
représailles des coupeurs de route. Cette situation se complique davantage par le fait
que certains otages sont séquestrés en territoire étranger, ce qui ne permet pas aux
éléments du 3è BIR d’agir efficacement».
L’année 2005 est également marquée par la fréquence des enlèvements
d’enfants mais aussi d’éleveurs et de bergers. Dès le mois d’avril, le
journal L’Oeil du Sahel faisait un bilan indigné de la situation de
l’insécurité dans la partie de l’Adamaoua frontalière de la Centrafrique:
«Depuis quelques mois, le département du Mbéré est devenu la chasse gardée des
malfaiteurs. Cette unité administrative est en passe de battre le record d’attaques
des personnes des coupeurs de route dans l’Adamaoua. Alors qu’on n’avait
pas fini de digérer la mort tragique des personnes abattues en janvier dernier par un
groupe de rebelles centrafricains dans le district de Ngahoui, c’est au tour des
populations de l’arrondissement de Djohong, de vivre ce même calvaire à la suite de
l’enlèvement de vingt deux enfants par des inconnus. Au cours de cette opération,
les malfaiteurs ont abattu deux chefs de la communauté Mbororos».
En dépit des résultats obtenus par les forces de l’ordre dans la répression et la
récupération des otages, l’inventaire des actions des bandits montre que le
phénomène tend à prendre de l’ampleur. Tout d’abord, il se généralise dans
la mesure où ce ne sont seulement les zones frontalières qui sont concernées, car des
cas d’enlèvements sont désormais signalés à plus de cent kilomètres de la
frontière. Dans le même ordre d’idée, la frontière entre le Cameroun et la
Centrafrique n’est plus la seule concernée; le Tchad subit de plus en plus les
opérations des preneurs d’otages dans le sud-est notamment. A cela s’ajoute la
frontière nigériane, en l’occurrence dans la zone d’élevage de Gashiga où se
concentrent les campements mbororo vulnérables face aux raids de leurs congénères
venant du Nigeria. C’et ainsi que dans la nuit du 2 au 3 juin 2004, des assaillants
mbororo venus du Nigeria voisin, mettent le village de Koza II dans la province du Nord à
feu et à sang. Neuf personnes sont tuées (égorgées ou à coup de machette), les
récoltes brûlent dans l’incendie d’une centaine de maisons, les assaillants
emportent de l’argent et une quinzaine de bœufs. En outre, le nombre
d’enfants enlevés à la fois ainsi que le montant de la rançon exigée par enfant
semblent augmenter d’année en année; en 2003-2004, les cas étaient peu nombreux
où une dizaine d’enfants étaient enlevés à la fois dans le Nord-Cameroun et la
demande de rançon oscillait autour d’un million de francs CFA par enfant, alors
qu’aujourd’hui l’on signale de plus en plus des cas où une vingtaine
d’otages sont séquestrés pour une rançon de l’ordre d’une centaine de
millions. D’une part, cela donne l’impression que les réseaux de prise et de
séquestration d’otages s’affinent et prennent une dimension régionale.
D’autre part, tout comme ce fut le cas avec la recrudescence des grandes opérations
de banditisme rural, l’on assiste à l’installation de la traite des enfants se
caractérisant par une plus grande prise de risque en contrepartie d’une plus grande
rentabilité.
L’exigence faite aux parents de traverser la frontière pour aller payer la rançon
dans le pays voisin complique davantage la situation aussi bien pour les parents que pour
les forces de l’ordre. Les premiers, en particulier les Mbororo, sont à la fois
marqués par leur frilosité quasi-atavique vis à vis des détenteurs de l’autorité
et traumatisés par la promesse des malfaiteurs d’exécuter les otages en cas
d’alerte aux forces de l’ordre. Les cas sont fréquents comme celui de la prise
d’otages de Libong-Mbassana près de Tignère le 16 janvier 2004, où les éleveurs
préférèrent s’acquitter d’une rançon de 14 millions plutôt que de se
confier aux forces de l’ordre. Ces dernières sont quant à elles handicapées par
une logistique insuffisante (en hommes et en matériel roulant notamment) et surtout par
la timidité de la coopération sécuritaire transfrontalière ne leur permettant pas de
poursuivre, de rechercher les bandits dans leurs retraites.
Enjeux régionaux et répression
Les pages qui précèdent montrent l’ampleur prise par la criminalité
transfrontalière dans une région où la coopération interétatique en matière de
sécurité est mitigée. Au-delà de son impact économique et humain, le banditisme
transfrontalier tel qu’il s’exerce aujourd’hui dans les zones de
convergences des frontières du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad soulève la
problématique de la guérilla criminelle dans ce qu’elle entraîne comme
conséquences sur la stabilité des Etats concernés, obligés de coopérer pour contenir
la désintégration des zones frontalières, voire endiguer la formation ou la
reconstitution de groupes armés usant du banditisme comme moyen une nouvelle forme de
mécénat politique.
Des réfugiés du banditisme, du financement de nouvelles rébellions
Face à la pression des preneurs d’otages et à la fréquence des exécutions
d’enfants ou de bergers pour non paiement de la rançon, les zones cibles des bandits
se vident de leurs habitants, tandis que fonctionnaires et autres agents de l’Etat
recherchent les voies et moyens de se faire affecter ailleurs.
Depuis le début de l’offensive qui avait conduit François Bozizé au pouvoir, le
sud tchadien recevait des réfugiés centrafricains. A ces réfugiés, se sont ajoutés
les migrants du crime. D’une part, les attaques des bandits sur des campements
d’éleveurs généralement isolés obligent ces derniers à s’en aller.
D’autre part, les affrontements entre les Forces Armées Centrafricaines (FACA) et
les rebelles/bandits aggravent l’insécurité, rendant difficile la pratique de
l’élevage dans la mesure où il est malaisé de se rendre aux pâturages. Pour les
Mbororo qui se sont installés dans le nord-ouest de la Centrafrique pour fuir les
coupeurs de route dans le Nord-Cameroun, un nouvel exode s’impose, soit vers le
Tchad, soit vers l’Adamaoua. Aux départs individuels succèdent des déménagements
de campements entiers, puis des migrations impliquant des milliers de personnes conduisant
d’innombrables troupeaux de boeufs, moutons et chèvres. Le bureau du HCR à Yaoundé
estime qu’entre avril 2005 et juillet 2006, quelque 20.000 personnes ont quitté
leurs villages situés dans le nord-est du Cameroun, dans le nord de la RCA, ou dans le
sud-ouest du Tchad, après plusieurs attaques des coupeurs de route ou d'autres groupes
armés. Ceux qui n’émigrent pas se cachent dans les champs, en forêt, ou alors
rejoignent des parents dans les centres urbains.
Mais la migration ne procure pas un asile sécurisant dans la mesure où les zones de
pâturages dans lesquelles les éleveurs se replient correspondent à des espaces
fréquentés par les groupes armés. Dès lors, fuyant les attaques des bandits, les
éleveurs se retrouvent au contact d’autres bandes d’agresseurs, si ce ne sont
les bandes centrafricaines qui les y poursuivent: «Former centrafricans combattants
attack, loot and kill Bororo cattle keepers in the areas bordering Cameroun, forcing them
to cross the border. The ex-combattants have followed their victims into Cameroon and
caused the displacement of an additional 15,000 Cameroonians.» En effet, à
l’intérieur même du Cameroun, les déplacés du banditisme sont de plus en plus
nombreux. Les zones de Djohong et de Ngahoui, naguère réputées pour la richesse de leur
cheptel et la grande fréquentation du marché sous-régional à bétail qui s’y
tenait, ont dépéri. Le marché n’est plus fréquenté et les éleveurs sont allés
en Centrafrique ou se sont repliés vers l’intérieur de l’Adamaoua. Les sièges
de villages se multipliaient, comme celui du 5 juillet 2005 à Moni dans le Mbéré ; des
bandits venus de Centrafrique ont abattu le chef de village et réquisitionné dix
habitants du village pour transporter le butin. Pareils épisodes en se multipliant
convainquent les éleveurs de se rapprocher des zones fréquentées. C’est ainsi que
le long de la route menant de Meiganga à Garoua-Boulaï entre les provinces de
l’Adamaoua et de l’Est, des villages spontanés se sont implantés. Là se sont
installés des éleveurs peuls et en particulier mbororo qui ont chacun une histoire à
raconter, faite de deuil, d’humiliation et de déclassement social .
Des émigrés de Rey Bouba fuyant les rigueurs de l’administration néo-féodale du
Laamiido Abdoulaye Ahmadou (1975-2003) pour s’installer en bordure de la route
principale Ngaoundéré-Garoua aux migrants du banditisme installés le long de la route
entre Garoua-Boulaï et Bertoua surtout, l’on assiste au Cameroun à la naissance
d’un nouveau mode d’occupation de l’espace et d’un habitat interurbain
triplement fonctionnel : habitat de sécurité car en s’installant en bordure
d’une route très fréquentée, les gens sont à l’abri des sièges des villages
par les bandits ; habitat économiquement rentable du fait de l’exposition en bordure
de la route des produits de saison et autres denrées de consommation courante que les
émigrés fabriquent, cultivent ou cueillent dans la brousse environnante (céréales,
tubercules, fruits, bois de chauffe, œufs, oléagineux, nattes, chapeaux en paille,
etc.); habitat de compromis aussi dans la mesure où ils s’installent sur des terres
vacantes en contrepartie d’un tribut modique payé au lointain chef traditionnel dont
dépend le territoire, voire une prise de possession d’une bande de terre forestière
que personne ne leur conteste.
Dans ce contexte d’exode, les agents de l’état affectés dans les zones
d’insécurité abandonnent les lieux de service : écoles primaires, centres de
santé et autres services techniques de l’Etat se vident de leurs personnels qui, en
attendant l’aboutissement de leurs demandes d’affectation, renvoient femmes et
enfants vers des lieux plus sûrs ; d’aucuns font la navette entre la ville où ils
résident et les villages où ils travaillent. L’affectation dans le Mbéré proche
de la Centrafrique est perçue par certains de mes interlocuteurs comme une affectation
disciplinaire, un règlement de comptes. « Ils m’ont envoyé au front », dit
l’un d’entre eux comparant sa promotion comme responsable dans la région au
sort d’un sergent promu capitaine, mais sur le champ de bataille. En tout cas,
l’exemple du maître de l’école publique de Biel proche de Ngahoui sévèrement
battu par les preneurs d’otage venus enlever le fils du chef de ce village,
n’est pas pour stimuler le zèle des fonctionnaires.
Naguère, au temps du Front de Libération Nationale du Tchad (FROLINAT) et de la
pléthore de factions militaires qui animèrent la rébellion tchadienne entre 1966 et
1982, des mécènes étrangers procuraient aux seigneurs de la guerre la logistique, les
moyens financiers et le soutien politique nécessaires. C’était l’époque de la
Guerre Froide et de la guerre d’influence entre la France et la Libye. Le première,
désireuse de maintenir le Tchad dans le giron de son pré-carré francophone,
n’entendait pas laisser le Colonel Mouammar Kadhafi faire main basse sur le Tchad. Ce
dernier, à la recherche de l’allié providentiel qui lui permettrait de se
substituer à l’influence française au Tchad et ouvrir la voie à une plus grande
influence libyenne en Afrique subsaharienne, s’essaya à soutenir successivement
différentes tendances belligérantes : «utilisation simultanée ou successive de tous
les protagonistes du conflit, permutation des alliances, vraies interventions armées et
faux retraits, conciliations et raidissements, la Libye a créé ou subi toutes les
situations imaginables au Tchad ». (Otayek, 1987 : 200) L’aide militaire française,
les pétrodollars libyens ou les ressources du gouvernement soudanais étaient mis à la
disposition des parties en conflit. Argent et soutien politique faisaient le bonheur des
rebelles, car en attendant d’accéder au pouvoir, ils n’étaient pas dans le
manque. Comme pour les bandits, pour les rebelles aussi les temps ont changé. La Guerre
Froide est finie, Kadhafi s’investit davantage sur le plan diplomatique pour
réaliser son dessein de leadership d’une Afrique unie, la France soutient Idriss
Déby. Si Karthoum est toujours intéressé par ce qui se passe à N’Djamena, le
fiasco de la tentative de prise de pouvoir par le Front Uni pour le Changement (FUC) en
avril 2006 montre que l’aide soudanaise comme facteur d’alternance à
N’Djamena n’a plus la même efficacité qu’à l’époque de la marche
vers le pouvoir de Hissène Habré et de Idriss Déby. Pour leur survie et pour
équipement, les rebelles allient banditisme et lutte politique.
Ce n’est pas un phénomène nouveau que sous couvert de lutte politique des
communautés en armes ou des combattants s’adonnent à des embuscades, raids,
pillages et autres modalités au demeurant polysémiques du banditisme rural. Communautés
claniques animistes contre pouvoirs centralisés musulmans avant et pendant la
colonisation européenne (Saibou et Adama, 2002) ou mercenaires lors des affrontements
interethniques dans le Logone et Chari à l’extrême-nord du Cameroun dans le
contexte de l’ouverture démocratique pour ne prendre que ces exemples, les
technologies de la violence génératrice de revenus ont affiné les modes de
rentabilisation du désordre et des carences sécuritaires de l’Etat dans le bassin
du Lac Tchad. Il y a là une continuité historique qui cependant innove au gré du
contexte. Dans le cas d’espèce, l’on assiste à l’apparition de
rébellions transfrontalières dont l’aire d’approvisionnement épouse les
contours des espaces décrits ci-dessus et dont le sanctuaire est la zone de rencontre des
frontières de la Centrafrique, du Soudan et du Tchad. La tentative de prise de pouvoir à
N’djamena par le FUC montre l’avènement de ce nouveau type de rébellions de
plateforme, non pas porteurs de projets consistants mais associant des groupes armés
indépendants unis par le souci de revenir dans le sillage du pouvoir. La participation
des mouvements installés dans le nord de la Centrafrique à cette tentative,
l’éclatement du FUC au lendemain de l’échec et le ralliement de son chef
Mahamat Nour au régime Déby sont autant de faits révélateurs.
Si l’on ne dispose pas, en l’état actuel des recherches
effectuées sur le terrain des faits permettant d’attester le lien qui existerait
entre rançon et financement de rébellions en formation dans la région d’étude, il
reste que les témoignages et points de vues recueillis traduisent une inquiétude encore
plus grande que la pérennisation du banditisme de grand chemin. Pourvu qu’ils aient
les moyens nécessaires, les soldats errants peuvent s’offrir les instruments de leur
choix dans une région où les armes issues des multiples guerres d’Afrique Centrale
circulent en dehors des arsenaux officiels. Autant le sort du régime de François Bozizé
est lié à celui de Idriss Déby, autant le sort des rébellions tchadienne et
centrafricaine opérant dans leurs zones frontalières communes semblent liées
d’autant plus que cette zone est plus que jamais un espace de rencontre que l’on
redoute qu’il devienne une aire de coopération entre les forces rebelles aux
pouvoirs de Bangui et de N’Djamena: « Déjà, la crainte existe de voir le climat
d'insécurité qui persiste dans le nord de la RCA, essentiellement le long de sa
frontière avec le Tchad, représenter le signal d'une rébellion naissante. [...] Selon
les observations de l'UA, le caractère professionnel des opérations menées sur le
terrain, le recours à des éclaireurs et les itinéraires empruntés pour la retraite et
l'évacuation des blessés laissent penser que ces agresseurs ne sont pas de simples
bandits des grands chemins. En outre, la mission a prévenu que les
"ex-libérateurs", qui ont le sentiment d'avoir été abandonnés par le
général Bozizé, pourraient participer à toute opération de déstabilisation ciblant
son gouvernement. Le rapport indique également que la présence de déserteurs de
l'armée tchadienne avait été signalée dans les zones touchées par l'insécurité.
En plus, le modus operandi des groupes armés donne l'impression qu'ils pourraient, dans
l'avenir, recruter des éléments pour mener des opérations de grande envergure. »
Dans quelle mesure les rançons et les butins des embuscades contribuent-ils au
financement de rebellions émergentes plutôt qu’à entretenir des besogneux? Telle
est la question qui revient en filigrane dans les discussions qui transcendent la
dimension strictement criminelle des attaques des ”Libérateurs”. Tout compte
fait, la régionalisation de l’insécurité et ses corollaires que sont la
multiplication des réfugiés et des personnes déplacés dans les trois pays, ainsi que
les menaces que font peser les groupes armés sur les régimes centrafricain et tchadien
imposent aux Etats de coopérer dans la sécurisation des zones frontalières.
De la répression unilatérale à l’initiative tripartite
Jusqu’à ce que le banditisme militaire transfrontalier devienne une potentielle
menace politique, seuls les cadres nationaux de répression fonctionnaient effectivement
dans la lutte contre la criminalité dans les zones frontalières. La coopération active
entre les forces de l’ordre des trois pays est tardive, car elle est consécutive aux
résultats des commissions mixtes de sécurité qui se sont tenues, pour ce qui est du
Cameroun et ses voisins, en 2005.
Contrairement aux provinces septentrionales du Cameroun où est déployé le troisième
Bataillon d’Intervention Rapide (3è BIR) qui a fait ses preuves dans la
sécurisation de la région, la province de l’Est n’est couverte que par les
forces de sécurité traditionnelles, en l’occurrence la gendarmerie. En attendant le
déploiement prochain du 2è BIR, les brigades indigentes en personnel et en logistique
peinent à contenir l’expansion du grand banditisme perpétré par des unités
aguerries, bien armées et dotées de moyen de communication sophistiquées. Aux
frontières communes de la Centrafrique et du Tchad, il est malaisé de dissocier les
opérations de sécurisation menées contre les acteurs du crime de celles conduites à
l’encontre de l’opposition politico-militaire. Cette confusion des ordres
politique et criminel avait gangrené par le passé la plupart des efforts de partenariat
bilatéral et multilatéral en matière de sécurité initiés notamment entre le Cameroun
et le Tchad en 1994 et dans le cadre de la Force Commune de Sécurité de la Commission du
Bassin du Lac Tchad (CBLT) en gestation depuis 1997. ”Nos malfaiteurs sont leurs
rebelles” est la maxime qui résume la délicatesse de la collaboration entre les
Etats voisins, car combattre des bandes armées dans le cadre d’une force commune ou
par-delà la frontière pourrait poser des problèmes d’ingérence dans les affaires
intérieures du voisin. Dans un contexte où les rebelles d’aujourd’hui sont
susceptibles de devenir les leaders de demain, il y avait des arrières-pensées
diplomatiques par rapport à ce que demain réserve. C’est donc une nouveauté, que
s’opère la coopération sur le terrain entre les forces de sécurité des trois
pays. Cette régionalisation de la répression porte des fruits: « Vendredi 8 juillet
2005, les éléments de l'armée centrafricaine se sont joints à ceux de l'armée
camerounaise pour un défilé militaire dans les rues de Toktoyo, une ville camerounaise
située à la frontière de deux pays. Les militaires ont ainsi présenté une vingtaine
d'otages camerounais initialement libérés des mains des rebelles tchadiens à Sagani, un
village centrafricain situé à 30 km de la frontière avec le Cameroun. Une libération
survenue le mercredi 5 juillet 2005, suite à une embuscade tendue par les forces armées
centrafricaines (Faca). Lors de ce défilé, les armes de guerre et munitions saisies des
mains des rebelles ont été également exposées. De quoi rassurer les populations des
deux pays et attester de la volonté des deux pays d'agir en synergie pour barrer la route
aux rebelles qui se comportaient déjà comme en terrain conquis.» (Chi Elvido, 2005).
Pour aboutir à la libération des cinquante otages camerounais et centrafricains,
l’armée centrafricaine avait bénéficié du concours des militaires français de
l’opération Epervier basée à N’Djamena et surtout de la collaboration de
l’armée camerounaise. Cette dernière fournit les renseignements qui permirent de
localiser les repaires des preneurs d’otages, en même temps qu’elle déploya
des hommes dans les zones de Ouli, Toktoyo, Gbiti, Kentzou et Kette pour empêcher la
retraite des bandits vers le Cameroun. C’était la première fois que trente et six
rebelles/bandits perdaient la vie dans un affrontement avec les forces de l’ordre.
Les résultats de cette conjugaison des efforts confortèrent le Cameroun et la
Centrafrique dans l’urgence d’une coopération sécuritaire formelle. C’est
ainsi qu’à la suite des efforts communs que la Centrafrique et le Tchad déployaient
à leur frontière commune, Yaoundé et N’djamena réactivèrent la commission mixte
de sécurité à Maroua en octobre 2005, suivie d’une réunion bilatérale entre les
autorités de Bangui et de Yaoundé à Bertoua en décembre 2005, laquelle aborda les
questions transfrontalières et consulaires. Près d’un demi-siècle après
l’accession des deux pays à l’indépendance, la réunion de Bertoua permit de
formaliser la coopération bilatérale de en matière de sécurité entre le Cameroun et
la Centrafrique : «Abordant les questions de sécurité transfrontalière, les deux
délégations ont déploré la recrudescence du grand banditisme, phénomène se
manifestant à travers notamment l'action des coupeurs de route, les razzias dans les
villages, les prises d'otages avec demande de rançon, la prolifération et le trafic des
armes de tout calibre, l'existence des filières de vol de véhicules et de bétail, le
braconnage et l'exploitation illégale des pierres précieuses. Elles ont en outre relevé
la multiplication des incidents au niveau des frontières ; ainsi que le phénomène de la
fraude et de la contrebande qui compromet considérablement les rentrées fiscales et
douanières. Face à tous ces phénomènes, les deux délégations ont souligné la
nécessité d'une coordination et d'une mobilisation accrue des moyens en vue de la lutte
efficace contre ces fléaux. Elles ont à cet égard préconisé la sensibilisation des
populations en vue de leur implication effective dans la lutte contre l'insécurité
transfrontalière ; le renforcement et la promotion de la coopération militaire et
judiciaire; ainsi que le resserrement des bornes frontalières. […] Par ailleurs, et
en vue de pallier à l'inexistence d'un cadre institutionnel de concertation bilatérale
en matière de sécurité, les deux parties ont examiné et adopté un avant-projet
d'accord portant création de la Commission mixte permanente de sécurité, pour
soumission à la sanction des autorités compétentes».
La mise en oeuvre et l’efficacité d’une telle initiative dépend certes de la
volonté politique des dirigeants, mais surtout de la qualité et de la quantité des
unités affectées à la surveille d’une frontière longue et poreuse d’une part
et d’autre part à l’aptitude à s’adapter aux mutations des modes et des
lieux d’opération des malfaiteurs. Si le Cameroun a essentiellement des ambitions
sécuritaires avérées dans ce partenariat, il est vraisemblable que du côté de Bangui,
des considérations plus défensives sous-tendent l’établissement d’un cadre
bilatéral de sécurisation. A ce propos, une source rapporte la ”tentative
d’embrigader le Cameroun dans un accord de défense qui obligerait Yaoundé à
intervenir plus radicalement dans les multiples différends centrafricains”
(Ketchateng, 2005).
Conclusion
Dans ce texte, j’ai essayé de montrer comment le contexte du
changement de régime en Centrafrique en 2003, a créé les conditions du renouveau de la
criminalité transfrontalière, ouvert la voie à une nouvelle forme de financement de la
lutte armée dans cette partie de l’Afrique Centrale et jeté les bases de la
désagrégation de la société pastorale mbororo. En substance, il ressort de cette
étude que la crise centrafricaine corrobore l’idée selon laquelle en Afrique
Centrale, il n’ y a plus de crise nationale au sens strict du terme. Ce qui était
vrai pour les Grands Lacs, l’est aujourd’hui pour la zone de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique dont font partie le Cameroun, la Centrafrique
et le Tchad. L’émergence des multinationales du banditisme transfrontalier, la
militarisation du crime organisé, la criminalisation et la transnationalisation des
rébellions érigent la régionalisation de l’insécurité en un problème de
défense nationale pour tous les Etats concernés. Seulement, les prudences diplomatiques
et les impératifs sécuritaires imposent d’abord le renforcement des moyens
nationaux de répression plutôt que de reposer entièrement sur les stratégies
sous-régionales de sécurisation transfrontalière dont la mise en pratique ne pourrait
occulter les considérations politiques.
Au demeurant, pendant que l’action des forces de l’ordre bénéficie d’un
meilleur échange d’informations entre les unités frontalières, permettant de
libérer davantage d’otages et d’éliminer des bandits, ces derniers
s’adaptent à la situation:
- L’on assiste de plus en plus à ce qu’on appellerait les
”razzias d’otages” comme si les assaillants tentaient leur chance une fois
pour toutes en enlevant de nombreuses personnes pour une rançon importante
réinvestissable. C’est l’exemple parmi tant d’autres d’une opération
survenue dans la nuit du 18 au 19 décembre 2006 à une cinquantaine de kilomètres de
Garoua, capitale provinciale du Nord. Sept Mbororo membres d’une même famille sont
enlevés par un gang conduit par une jeune Mbororo de 22 ans.
- Les zones frontalières et rurales ne sont plus les seules visées,
comme le montre l’attaque survenue à Bélel en décembre 2006 ou celle de Bibémi
dans la nuit du 14 au 15 janvier 2007. il s’agit d’une forme d’insécurité
urbaine émergente contre laquelle la coopération transfrontalière n’a pas de
remède;
- Les preneurs d’otages locaux ne cherchent plus absolument à
traverser la frontière avec leurs victimes et exercent une pression psychologique sur les
parents: ”Ils nous ont dit que la date butoir pour le paiement de la rançon était
passée. Comme nos parents n’aveient pas réussi à tenir leurs promesses, eux
tiendraient les leurs: exécuter les otages. Ils ont pris trois de nos camarades
d’infortune et les ont tués par rafales, racontent Ibrahima et Issa, âgés de 12 et
15 ans respectivement. Profitant de la nuit, les deux enfants se sont évadés pour
rejoindre leurs parents [...] Quand au site exact d’exercice, les otages les disent
très mobiles et très organisés. Ils sont une centaine de personnes armées, prenant à
tour de rôle la garde et laissant à des dizaines de kilomètres des éclaireurs sur les
collines et les arbres pour faire le guet” (Djacba, 2007).
Ce sont là autant de nouveaux développements qui complexifient davantage
l’insécurité liée à la prise d’otages dans le Nord-Cameroun, le Nord-Ouest
de la RCA et le Sud-Ouest du Tchad. Cette situation remet à l’ordre du jour toute la
question des libertés de mouvement des hommes et de desserrement de l’étau policier
de l’Etat alors même que l’état de crise ambiant pourrait requérir la mise en
place d’un état d’urgence sécuritaire dans les zones rurales.
Notes
(1) Ce sont: Groupement Polyvalent d’Intervention de la Gendarmerie (GPIG) et
Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) au Cameroun, Office Central de Répression du
Banditisme (OCRB) en Centrafrique et l’unité de Recherche, Assistance, Intervention
et Dissuasion (RAID) au Tchad qui reproduit le RAID français.
(2) C’est ce que résume si opportunément André Marty dans les
lignes suivantes: « Nous avons en effet été frappé par le nombre important de Bororo
devenus des bergers salariés, sans compter ceux qui se clochardisent dans les grands
centres. Ce changement est incontestablement lié à la perte du cheptel sous l’effet
de plusieurs facteurs: peste bovine, mouche tsé-tsé, obligation de vendre plus
d’animaux pour couvrir les besoins en raison de la chute des prix, tracasseries de la
part des agriculteurs et des autorités, paiement des dégâts champêtres sous forme
d’animaux, versements de ”cadeaux” en nature, etc. Un certain nombre de ces
nouveaux pauvres trouve des emplois de bergers salariés. La rémunération est
généralement très faible, même si les formes de contrats sont très variables: un
taurillon, des céréales, des habits ou plus souvent 25 000 F tous les cinq mois, ce qui
est nettement inférieur aux plus bas salaires de la fonction publique [...]. On comprend
alors que ces bergers soient en quelque sorte ”rejetés” de leurs parents qui
transhument encore pour eux-mêmes. Ces derniers craignent de leur confier des animaux,
voire de leur accorder des prêts de femelles avec accès possible à l’appropriation
d’une partie de la descendance. Tout se conjugue hélas pour qu’à la perte de
l’autonomie économique se mêle l’équivalent d’une redoutable exclusion
sociale » (Marty, 1992 : 53)
(3) Lettre de Wadjiri Ori du village de Foungoy (Tignère) à Monsieur
le Préfet du département de l’Adamaoua à Ngaoundéré, 17 février 1963.
(4) Le Président, le Dr Hamadama Hassan se fait l’écho en ces
termes : « Du fait que cette communauté vit en marge du reste de la société, du fait
qu’elle n’est pas impliquée dans l’émancipation et la vision moderne des
choses, elle est directement exploitable. Il n’y a qu’à voir comment certaines
autorités administratives, certaines autorités traditionnelles, certains hommes bien
placés, comment ces hommes là exploitent les populations peules mbororo du Cameroun.
C’est véritablement un scandale. Vous connaissez les problèmes du Nord-Ouest, ici
dans l’Adamaoua, vous connaissez un peu les exactions des forces de l’ordre qui
s’érigent en hommes de justice dans les campagnes. C’est une situation
excessivement difficile, excessivement grave. Je dirais que, en ce qui concerne
l’homme mbororo, la crise a fait que le respect des droits de l’homme est
plutôt allé de façon régressive au Cameroun. Il y a 20 ans, le Mbororo ne subissait
pas la pression d’exploitation qu’il subit aujourd’hui. Malgré toutes nos
interventions au niveau administratif pour que cet état de choses cesse, les problèmes
demeurent et c’est un problème fondamentalement important pour notre communauté »
(Interwievé par Abdoullahi Baba, octobre 2002).
(5) Sur cette question, voir Saïbou Issa, “Chad’s vicinity
and ethnic warfare in the Logone and Shari Division (Far North Cameroon)”
(6) « Les rebelles qui sèment la terreur dans la zone frontalière
entre le Cameroun et la RCA, sont pour la plupart des éléments ayant pris part à la
rébellion qui a porté François Bozizé au pouvoir en mars 2003. une force hétéroclite
dans laquelle on retrouvait des éléments des forces armées centrafricaines (FACA), des
engagés volontaires centrafricains, mais également ces fameux ”Zakawas”, des
Tchadiens ne justifiant pas toujours d’une formation militaire, mais rompus au combat
par les nombreuses années de guerre dans ce pays voisin [...] Seulement, nombre de ces
”libérateurs”, coupables de nombreux abus sur les populations à leur arrivée
à Bangui, ne seront pas intégrés dans les FACA comme ils l’espéraient. Le
Programme de réinsertion des anciens combattants, basé à Bangui, initié par le
Programme des nations unies pour le développment (PNUD), ne les intègre pas dans son
action. Des sources à Bagui indiquent que les ”Zakawas” recevront chacun 500
000 F CFA du gouvernement centrafricain avant d’être mis en route pour retourner au
Tchad. Certains ”Zakawas”, munis de tout l’arsenal de la campagne
centrafricaine, vont juste s’éloigner de Bangui et se positionner en seigneur de
guerre dans la zone frontalière entre le Cameroun, le Tchad et la RCA. Ils se muent en
malfrats qui profitent au maximum de la porosité de la frontière camerounaise pour
spolier, kalachnikovs au point, pasteurs et commerçants » (Ndachi Tagne, 2005).
(7) « Déroute des coupeurs de route à la frontière avec la RCA,
Cameroon-Info.Net, 14 juillet 2005.
(8) Interview de Mbodu Saïd, Consul du Tchad à Garoua, L’Oeil du
Sahel,
(9) Sur cette question, voir Saïbou Issa, 2004, « L’embuscade
sur les routes des abords sud du Lac Tchad », Politique africaine, 94, pp. 100-103 ;
Karine Bennafla, 2002, Le commerce frontalier en Afrique centrale : acteurs, espaces,
pratiques, Paris, Karthala, pp. 170-172.
(10) Rapportant le désarroi d’un éleveur camerounais à la suite
de l’enlèvement de son enfant, une source relève le changement de méthode des
bandits: «Un modeste éleveur (…) dans le Nord-Cameroun, cache avec peine ses larmes
au sortir du marché au bétail où il vient de brader à la hâte sept de ses bœufs.
« Voici 400 000 Fcfa, marmonne-t-il, je viens de vendre mes bœufs pour aller
chercher mon fils unique Nana qu’ils ont pris avec eux en brousse. Passé demain
soir, ils vont lui enlever la vie ». Depuis un an les éleveurs sont devenus la cible
favorite des coupeurs de route (…). Très organisés, ces groupes d’hommes
venant de toute la sous-région (Tchad, Centrafrique, Nigeria), souvent d’anciens
militaires bien armés, font irruption dans les villages en groupes de 20 ou 30. Ils
enlèvent les jeunes enfants qui ont moins de douze, treize ans. En effet, ceux-ci sont
sans défense et ont du mal à donner des témoignages précis qui permettraient de mettre
la main sur les brigands. En échange de leurs otages, ils réclament de fortes sommes
d’argent, ce qui oblige les parents à vendre des têtes de bétail. Le premier rapt
d’enfant a eu lieu le 21 novembre 1996. Ce jour-là, 13 enfants issus de plusieurs
villages ont été arrachés à leurs parents. Depuis lors les enlèvements n’ont pas
cessé et sont devenus particulièrement fréquents depuis août» 1997.
(11) Sources : entretiens.
(12) Pour lire l’ensemble de l’interview qui relève notamment
l’organisation de la répression, on pourra aller sur
http://www.centrafrique-presse.com
(13) « Oumarou Madiki lance un cri de cœur au gouvernement pour la
protection des éleveurs », http://www.wmaker.net/leconfident
(14) « L’armée centrafricaine libère des enfants
d’éleveurs pris en otages », http://www.sangonet.com
(15) « Les zones de Zaraguinas dans la Kaga-Bandoro »,
http://www.wmaker.net/leconfident
(16) « L’armée centrafricaine libère des enfants
d’éleveurs pris en otages »,
http://www.sangonet.com/ActualitéC1/enf-eleveurs-liberes.html
(17) Sources militaires, 2004.
(18) Douworé Ousmane, « Mbéré, les rebelles tchado-centrafricains
s’installent », L’œil du Sahel, n° 161 du 18 avril 2005.
(19) Sources : entretiens.
(20) Grioo.com, 20 April 2005, Plus de 18.000 personnes fuient les
"coupeurs de route" au Cameroun
(21) Un de mes interlocuteurs témoigne sous le couvert de
l’anonymat : « En rendant la transhumance impossible, en nous prenant nos
bœufs, les bandits ont réussi ce que toutes les autorités depuis le temps des
Blancs, n’ont pas pu réaliser, à savoir contraindre le Mbororo à la
sédentarisation. Parmi nous, dans les campements dispersés dans la zone où on habitait
en Centrafrique, beaucoup de nos enfants ont été pendus. Des parents se sont laissés
mourir, des femmes ont fait des fausses couches en apprenant les interminables nouvelles
tristes. Nous sommes appauvris, nous sommes dans la détresse. Aujourd’hui, nous
sommes réduits à solliciter la protection de l’administration, alors que pendant
des années, nous avons perçu cette administration comme la grande ennemie de notre
société, de notre genre de vie. Maintenant que notre richesse s’est
considérablement réduite, les gens voudront-ils nous protéger ? »
(22) Anaclet Rwegayura, Correspondant de la PANA à Addis-Abeba, PANA,
Addis-Abeba – 29 décembre 2005.
(23) Pour les détails de cette question, voir Saïbou Issa, 2004, « Le
mécanisme multilatéral de la CBLT pour la résolution des conflits et la sécurité dans
le bassin du Lac Tchad », Enjeux, décembre 2004.
(24) Extrait du communiqué final conjoint de la réunion de la
commission mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et la République Centrafricaine,
Bertoua, 15 décembre 2005.
(25) Albert Djacba, « Bibémi : des coupeurs de route exécutent leurs
otages », L’œil du Sahel, n° 225 du 29 janvier 2007.
Références bibliographiques
• Bayart, J. F. et al., The Criminalisation of the State in Africa,
Oxford/Bloomington/Indianapolis, James Curey/ India University Press, 1999
• Bennafla, K., Le commerce transfrontalier en Afrique centrale :
acteurs, espaces, pratiques. Paris, Kathala, 2002
• Bocquéné, H., Moi un Mbororo. Autobiographie de Oumarou Ndoudi,
Peul nomade du Cameroun, Paris, Kathala, 1986
• Buijtenhuijs, R., Transition et élection au Tchad: 1993 - 1997.
Restauration autoritaire et recomposition politique. Paris/Leyde, ASC/Karthala, 1998
• Chi Elvido, « Cameroun-RCA : les rebelles tchadiens sévissent
à nouveaux », Le Quotidien Mutations, 16 juillet 2005
• Djacba, A., « Bibémi : des coupeurs de route exécutent leurs
otages », L’oeil du sahel, n° 225, 29 janvier 2002.
• Emangongo, E., « Grâce à la coopération Cameroun-RCA, la FAC
tue 36 rebelles au Nord-ouest », Le Potentiel (Kinshasa), 12 juillet 2005
• Ketchateng, J. B., «La première commission mixte de sécurité
s’est achevée hier à Bertoua », Mutations, 16 décembre 2005
• Lea, J., « Social crime revisited », Theoretical Criminology,
vol. 3 (3), 1999
• Marty, A. ; Etude régionale des stratégies différenciées des
éleveurs d’Afrique Centrale : le Nord-Cameroun, Paris, IRAM, 1992
• Mburu, N., « Contemporary banditry in the Horn of Africa :
causes, history and political implications », Nordic Journal of African Studies, vol. 8,
n° 2, 1999
• Ndachi Tagne, D., « Tchad/Cameroon : les soldats camerounais
tuent 10 Tchadiens après affrontement » Alwihda (Tchad), 24 avril 2005
• Otayek, R., La politique africaine de la Libye, Paris, Karthala,
1987
• Saïbou, I., « L’embuscade sur les routes des abords sud du
Lac Tchad », Politique africaine, 94, 2004
• Sa¨bou, I., « Sonngoobe, bandits justiciers au Nord-Cameroun
sous l’administration française », Ngaoundéré Anthropos, vol. VI, 2001
• Saïbou, I. et Adama, H., « Vol et relations entre Peuls et
Guiziga sous la pleine du Diamaré au Nord-Cameroun sous l’administration française
», Cahiers d’études africaines, vol. 166, XLII-2, 2002
• Saïbou, I., « Le mécanisme multilatéral de la CBLT pour la
résolution des conflits et la sécurité dans le bassin du Lac Tchad », Enjeux, 2004